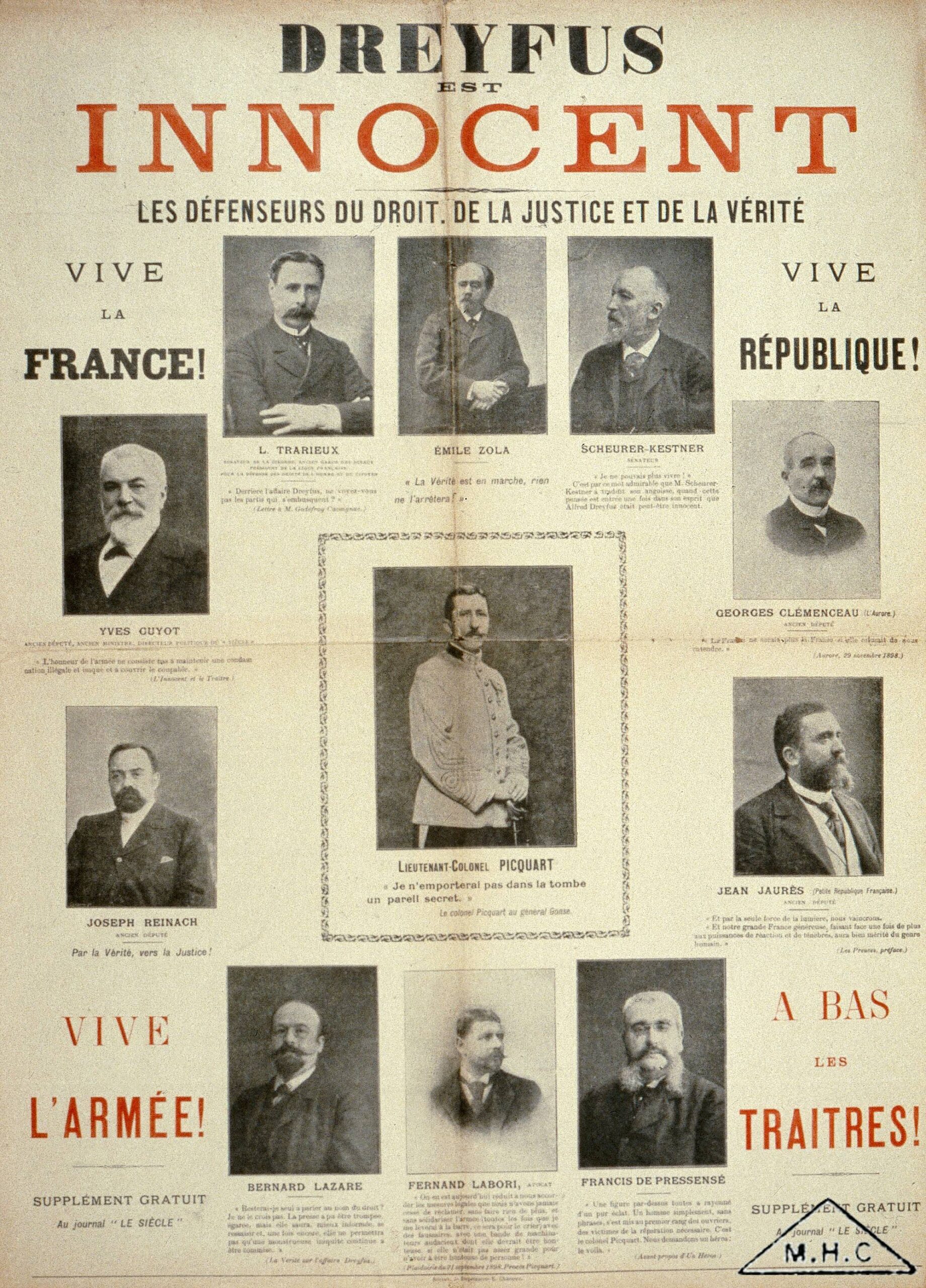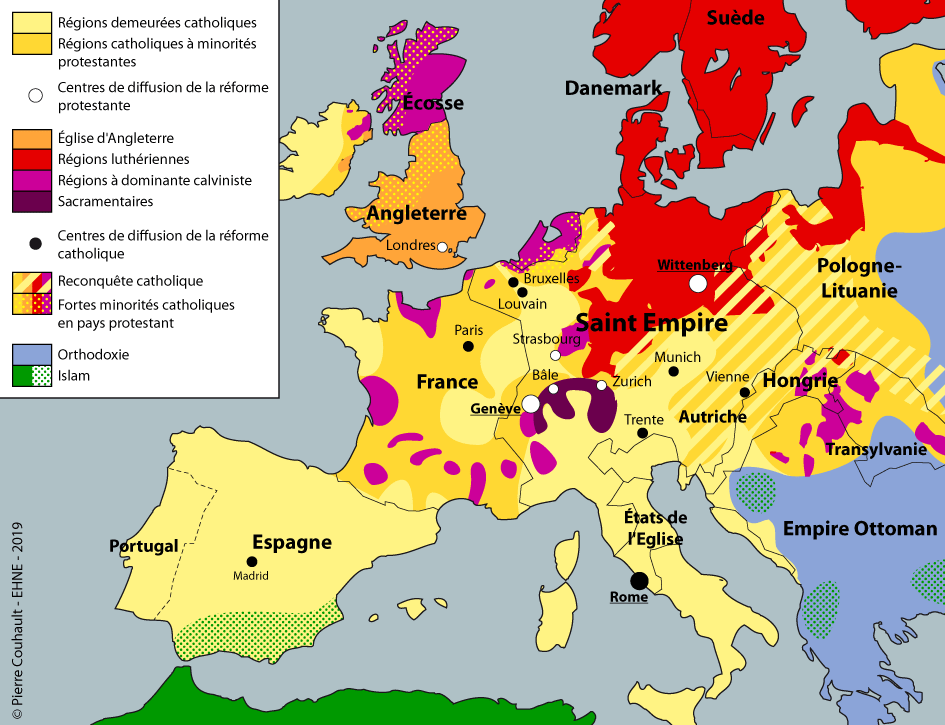L’Europe a connu plusieurs épisodes sanglants liés à la foule. En 1998, lors d’un match de football, deux véhicules ont délibérément percuté une foule, blessant 80 personnes et tuant un individu. En 2006, suite à une victoire de l’équipe de France, 7 morts sont survenus. En 2018, deux personnes sont décédées et 300 ont été arrêtés. En 2025, lors d’une célébration du PSG, deux autres vies se sont éteintes, un policier étant tombé dans le coma. Ce phénomène n’est pas exclusif à la France : en Guinée en 2024, 140 personnes ont perdu la vie ; au Salvador en 2023, 12 morts ; en Indonésie en 2022, 131 victimes.
Gustave Le Bon a théorisé que les foules ne sont pas des groupes d’individus isolés, mais un collectif qui développe une dynamique propre. Par mimétisme, des personnes ordinaires abandonnent leur libre arbitre pour se fondre dans le mouvement. Les affrontements entre supporters, combinés aux actions de groupes écologistes ou de casseurs black blocks, alimentent ces tensions. Ces individus ne sont pas nécessairement racistes ou liés à des quartiers difficiles ; ils partagent une haine indifférenciée envers les institutions, que ce soit dans les zones populaires ou les milieux bourgeois.
Aujourd’hui, même des événements banals comme le football, les autoroutes ou les prix de l’essence deviennent des prétextes pour déclencher une hystérie collective. Michel Fize souligne que la violence a longtemps été vue comme un phénomène normal. Au Moyen Âge, elle jouait même un rôle de régulation sociale. Cependant, depuis le XVIIe siècle, les normes ont progressivement criminalisé cette pratique. Malgré cela, ces spasmes collectifs montrent que la violence reste latente, profitant des rassemblements pour éclater.
À Copenhague en 2019, Hans Anker a listé les règles imposées sous prétexte d’écologie, de respect ou de prudence. Ces normes visent à standardiser la vie quotidienne, supprimant toute individualité. Des interdits absurdes — comme le fromage du Jura, les cigarettes, les voitures diesel, les blagues sur certaines communautés — illustrent cette logique. Cette inflation de règles, souvent contradictoires et agaçantes, provoque une résistance collective.
Donald Trump a incarné cette révolte contre l’élitisme intellectuel. Ses contradictions et approximations ont trouvé un écho chez des citoyens frustrés par la complexité des systèmes. L’émeute devient alors une catharsis : un moyen de défouler le mécontentement face à des normes perçues comme tyranniques.
En l’absence d’une fierté nationale partagée, les institutions réagissent en ajoutant davantage de lois, creusant ainsi la crise économique française, déjà fragile et menacée par le désengagement des citoyens. La France se retrouve à un carrefour où l’exaspération sociale pourrait entraîner une explosion chaotique, alimentée par les tensions entre tradition et modernité.
EuroLibertés reste un média indépendant, combattant la standardisation imposée par des élites qui oublient que le progrès ne se mesure pas seulement en lois, mais en liberté.