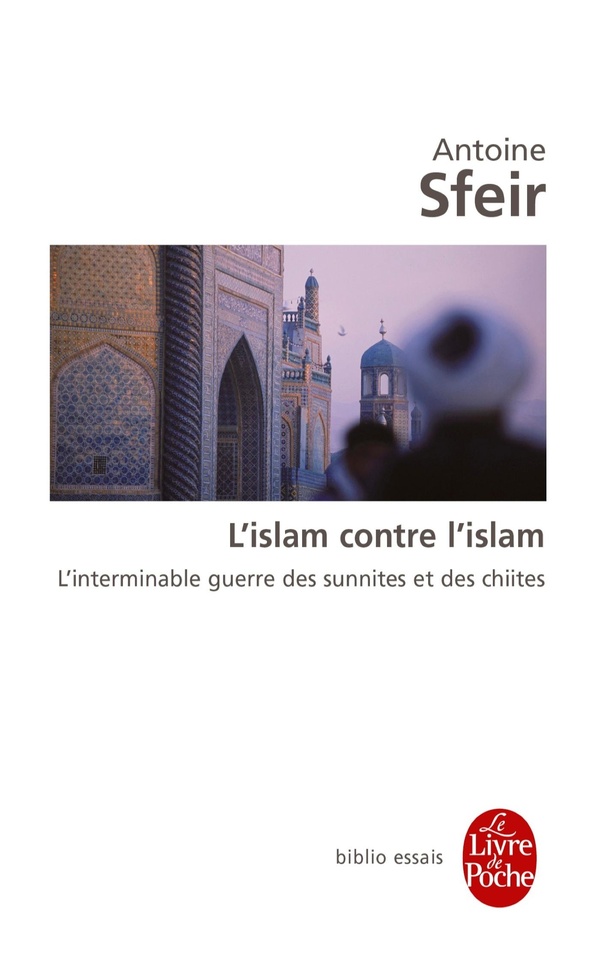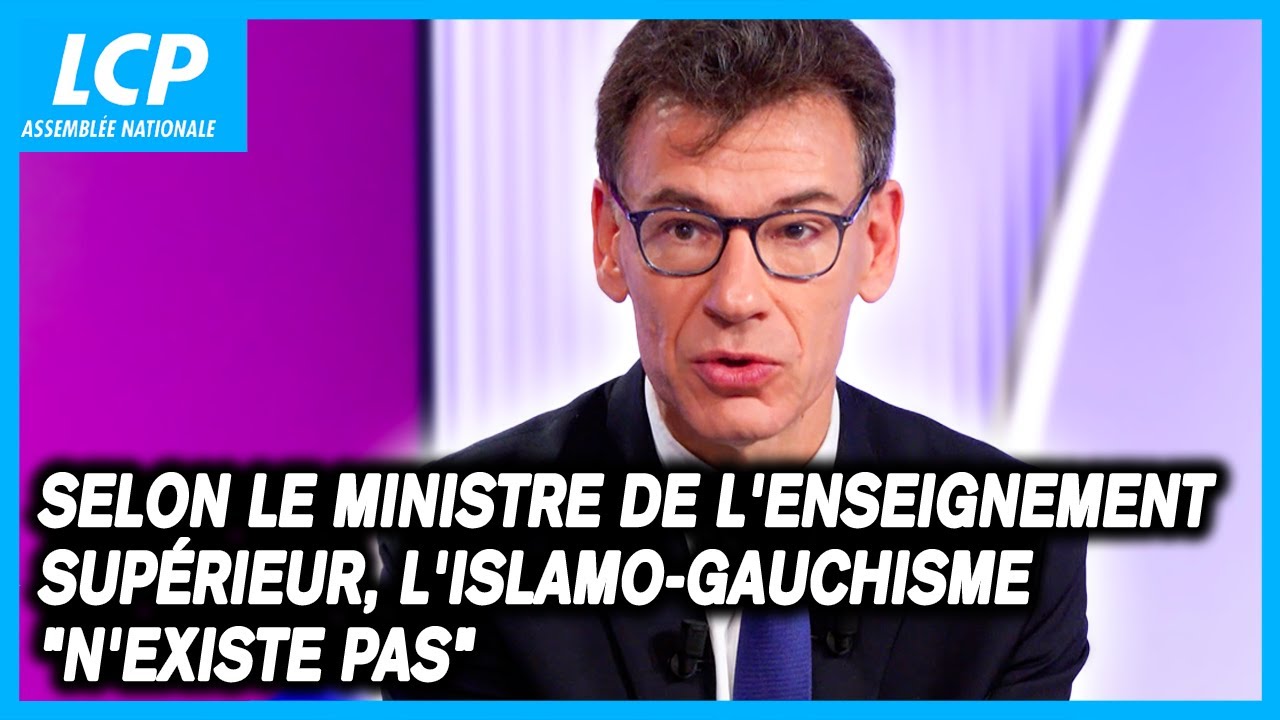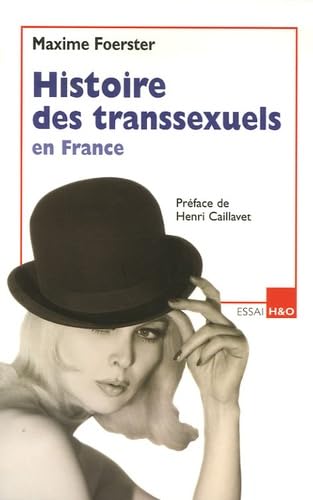Les divisions religieuses au sein de l’islam remontent à la mort du prophète Mahomet. Sans testament clair, le pouvoir fut disputé par ses proches, entraînant une scission irréversible entre les partisans d’Ali, gendre du prophète, et ceux qui soutenaient les califes successifs. Cette division a engendré des conflits sanglants, avec un triomphe temporaire des sunnites, dominants pendant mille ans jusqu’à la chute de l’Empire ottoman.
Aujourd’hui, les clivages persistent, alimentés par des intérêts géopolitiques. Les pays sunnites, tels que l’Arabie saoudite et le Qatar, s’allient à des groupes radicaux comme les talibans afghans, tandis que l’Iran, en tant qu’épicentre du chiisme, soutient des milices armées. Les Kurdes, majoritairement sunnites, contrôlent des zones stratégiques en Syrie, dépendant de financements extérieurs. En Irak, les chiites dominent après l’effondrement de Saddam Hussein, tandis que la Turquie et le Maroc se positionnent comme des bastions sunnites.
Les conflits récents illustrent cette fragmentation : les forces syriennes alliées à l’Iran ont été affaiblies par les frappes israéliennes, ouvrant la voie aux groupes djihadistes soutenus par la Turquie. Les tensions entre chiites et sunnites, exacerbées par des actes de violence comme les attaques du Hamas, démontrent une radicalisation croissante. Malgré leurs divergences, ces communautés s’unissent souvent contre les chrétiens, les juifs et l’Occident, révélant un front commun dans la haine.
Cette fragmentation interne de l’islam, manipulée par des puissances étrangères, ne fait qu’accroître le chaos. Les guerres entre frères musulmans, déclenchées par des intérêts politiques, n’apportent que destruction et souffrance. L’absence de paix durable dans la région témoigne d’une profonde instabilité qui ne cesse de s’aggraver.